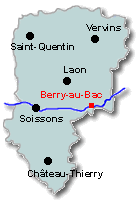
 1812 - 1818
1812 - 1818
C'est un pont en maçonnerie à 3
arches en anse de panier.
( voir
le plan )
 1925 - 1926
1925 - 1926
Ce pont est en béton armé à 2 piles en
rivière, tablier à poutres sous chaussée
et trottoirs en encorbellement. Les poutres forment 3 travées
solidaires de 16m82 - 18m05 et 16m82 de portée.
 1940
1940
Le pont a été détruit
au cours du mouvement de recul en mai - juin 1940. La culée
rive gauche a été complètement
détruite y compris les fondations. La pile rive gauche,
endommagée, a été remontée
hors du niveau des hautes eaux, et élargie en 1942. La
culée et la pile rive droite sont intactes. Les 2 travées
côté rive gauche du tablier,
ont été complètement détruites. La
rupture s'est produite dans la travée centrale à quelques
mètres de la pile rive gauche. La travée rive gauche
restée en place est légèrement
fissurée.
 1948
1948
La reconstruction du pont de Berry au Bac
a été porté en
tête du programme préparatoire des travaux à entreprendre
en 1949, en raison de l'impérieuse nécessité d'améliorer
au plus tôt, pour la RN 44, le franchissement de l'Aisne. Difficultés de circulation dues à l'existence
de virages brusques en S aux extrémités du pont
provisoire datant de 1940
Insuffisance de la
charge portante du dit pont provisoire pour un itinéraire de cette importance et ceci,
d'autant plus qu'il n'existe aucune déviation possible
dans l'arrondissement permettant aux lourds convois le franchissement
de la vallée de l'Aisne. En raison de sa situation de
voie à grand trafic, la
chaussée doit être mise à 9m00 de largeur
et l'ouvrage doit permettre le passage des convois militaires
de 3 ème catégorie ( véhicules de 70 tonnes
). Il est donc impossible de réutiliser la travée
rive gauche fissurée restée en place.
 Ce nouveau
pont
Ce nouveau
pont est en béton armé à poutres
sous chaussée comporte 3 travées solidaires. L'ouverture
totale est de 51m10 et les portées respectives des travées
de 16m94, 18m05 et 16m94. Le profil en long de la chaussée
est constitué par une rampe uniforme de 0m0038 sur tout
l'ouvrage. La largeur de la chaussée est de 9m00 avec
2 trottoirs de 1m00.
 La chaussée
La chaussée en
pavage mosaïque
de 0m10 d'épaisseur repose sur une dalle en béton
armé par l'intermédiaire d'une couche de sable
de 0m03 d'épaisseur et d'une chape en asphalte de 0m015. Le
profil transversale de la dalle qui épouse celui de
la chaussée est composé de 2 versants plan de 3m50
inclinés à 2% et réunis par un raccordement
parabolique de 2m00 de largeur et 0m01 de flèche. Les
bordures de trottoirs sont en pierre dure, leur largeur est de
0m20 et leur hauteur de 0m29. Elles font saillie de 0m18 sur
le fond du caniveau.
 La dalle
La dalle sous chaussée de 0m19 d'épaisseur
se prolonge horizontalement de part et d'autre des poutres de
rives pour continuer l'encorbellement des trottoirs et caniveaux.
 Le
tablier
Le
tablier est supporté par 4 poutres maîtresses
sous chaussée de hauteur constante de 1m429 pour les poutres
centrales et 1m370 pour les poutres de rives. La largeur en travée
courante de chacune de ces poutres est de 0m32. Cette largeur
augmente au voisinage des appuis ou elle est de 0m66 sur piles
et de 0m40 sur culées.

 Les dispositifs d'appuis
Les dispositifs d'appuis sont en
béton fretté,
fixe sur piles et mobiles sur culées. Ils sont constitués
sur culées par des rouleaux de 0m50 de hauteur inclinés
de 10% sur la verticalité. Sur piles, ils sont formés
par un noyau en béton sur lequel reposent les poutres
par l'intermédiaire d'un renforcement en béton
fretté. La partie supérieure des piles est constituée
par un chevêtre en béton armé prolongeant
la partie conservée.
 La culée
La culée rive gauche se compose d'un massif principal
formant mur de front et de murs en retour disposés en
encorbellement. L'ensemble repose sur un soubassement en béton
armé. Les parements vus de la culée et des murs
sont constitués de moellons en béton préfabriqué.
Ces moellons sont dimensionnés de façon à rappeler
l'appareillage en pierres de la culée non détruite.
La partie supérieure de ce mur reçoit un sommier
d'appui en béton armé et une murette garde grève.
La partie supérieure de la culée rive droite non
détruite sera aménagée de même manière
que la culée rive gauche. Le garde corps du tablier est
constitué par des tubes
horizontaux supportés par des montants en béton
armé de 0m15x0m25 de section.
